À la veille de ses 90 ans, notre confrère Marc Vignal retrace son parcours en compagnie de Jérémie Bigorie. Parcours d'une vie où l'auteur d'ouvrages essentiels consacrés à Haydn, Mahler, Sibelius, Vaughan Williams ou encore, tout récemment, Muzio Clementi, a toujours cherché à « servir d'intermédiaire entre la recherche et le grand public »
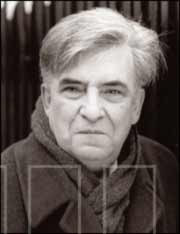
Jérémie Bigorie : À quand remontent tes premières émotions musicales ?
Marc Vignal : Je ne dirais pas que j’ai été « ému ». La première chose dont je me souviens est un spectacle auquel ma mère m’avait emmené au Palais de Chaillot où se produisait la compagnie de danse Janine Solane. Cette compagnie dansait sur la Symphonie pastorale de Beethoven. Je devais avoir 14 ans. Mais j’avais pris des leçons de piano dès 8 ans.
En conservatoire ?
M.V. : Non, je n’ai jamais fréquenté de conservatoire. C’était avec une amie de ma mère. Avec elle, je jouais à quatre mains des symphonies classiques (Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert), souvent à la basse, en clé de fa, et me suis familiarisé avec ce répertoire.
En dehors de ça, tu as suivi une scolarité normale dans le primaire et au lycée ?
M.V. : Oui.
Après, tu as suivi des études supérieures ?
M.V. : Sciences-Po, et j’ai été admissible à l’ENA en 1956.
Quand as-tu choisi la musicologie ?
M. V. : Je ne l’ai pas choisie, elle (ou plutôt la musicographie) est en quelque sorte progressivement venue vers moi. J’ai exploré les œuvres, à la radio et transcrites pour piano, puis j’ai fait des rencontres, grâce en particulier au Club des Trois Centres (des Jeunesses Musicales de France) qui organisait des séances d’écoutes de disques au Conservatoire Rachmaninov, avenue de New York. Je m’y suis rendu pour la première fois en avril 1956, alors que je préparais l’ENA, parce que j’avais lu dans le journal des JMF qu’y était organisée une soirée Sibelius, dont j’avais découvert la musique chez des amis en Angleterre deux ans auparavant. C’est au Club des Trois Centres que j’ai rencontré Pierre Vidal, qui s’en occupait, Harry Halbreich et Roger Tellart. Et un peu plus tard aux JMF Jacques Longchampt, le futur critique musical du Monde.
Nous sommes donc en avril 1956. Sibelius meurt en septembre 1957. Or je sais que tu es allé en Finlande de son vivant.
M.V. : A l’été 1956, avec des amis. Je me suis rendu à Ainola et j’ai aperçu dans le jardin Aino, son épouse. Elle cueillait des tomates, nous avons échangé un bonjour. J’ai laissé sur le pas de la porte un mot qu’on a retrouvé bien plus tard dans ses papiers.
Il l’aurait donc trouvé et lu ?
M.V. : Oui, certainement.
Que disais-tu dans ce mot ?
M.V. : C’était très court, en français (Sibelius parlait français) sur une carte de visite. Quelque chose comme « Je vous transmets l’admiration d’un groupe de jeunes mélomanes parisiens ».
Harry Halbreich étudiait à ce moment-là au Conservatoire.
M.V. : Il était élève de Messiaen. On a tout de suite sympathisé et découvert notre passion commune pour Haydn. Je me rappelle lui avoir dit en avril 1956 que Vaughan Williams allait donner une Huitième Symphonie, ce que – incroyable mais vrai– il ignorait. J’avais lu ça dans un journal anglais. Au festival de Donaueschingen 1960, où je me suis rendu avec Halbreich et d’autres, j’ai entendu Karl Amadeus Hartmann dire de lui : « Er macht alles » (Il fait tout).
En même temps que Sciences Po, tu as fait une licence d’allemand à la Sorbonne.
M.V. : Exact. Et lu pas mal de livres sur la musique, comme celui de Robbins Landon sur les symphonies de Haydn, paru en 1955 et que j’ai acheté à Londres l’année suivante. Ce livre a grandement élargi mon horizon, notamment sur ce que pouvaient être les activités musicologiques.
Et après ?
M.V. : Je me destinais à une carrière post-Sciences Po. De février 1958 à mai 1960, époque assez agitée, j’ai fait mon service militaire. J’ai eu de la chance, car au bout d’un an, j’ai été affecté au service de presse étrangère du ministère des Armées. Je lisais et épluchais la presse allemande et anglaise et dictais une revue de presse. D’autres faisaient de même sur la presse russe ou italienne. Pendant ce temps, j’ai fait la connaissance de Carl de Nys (futur membre de la PMi), qui écrivait beaucoup sur Mozart.
Il était ecclésiastique, non ?
M.V. : Oui, plus ou moins défroqué, comme Jean Massin, que j’ai bien connu plus tard. Carl de Nys m’a annoncé en septembre 1959 que Robbins Landon allait venir à Paris, à telle date, à tel hôtel. Le moment venu, en octobre suivant, j’ai mis un mot à son hôtel rue des Saints-Pères, Landon m’a téléphoné au ministère des Armées et invité à déjeuner. On a ensuite correspondu, je l’ai revu en juin 1963 au festival de Hollande où l’on donnait L’infedeltà delusa. J’ai été reçu chez lui en juillet suivant en Italie, où il vivait près de Florence. Il venait de fonder le Haydn Yearbook et m’a demandé d’en être le correspondant en France. Nous nous sommes souvent vus – à Vienne, à Paris, en Autriche, en France, à Dresde et ailleurs – et avons régulièrement correspondu jusque dans les années 2000. Au milieu des années 1980, il s’est établi à Rabastens, dans le Tarn.
Comment as-tu gagné ta vie après l’armée ?
M.V. : En novembre 1960, je suis entré comme salarié dans l’association Peuple et Culture, qui dépendait du ministère de la Jeunesse et des Sports.
En quoi consistait ton travail ?
M.V. : Dans le sillage de Joseph Rovan, essentiellement à faire du franco-allemand, dans le cadre – et avec les subventions – de l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), fondé en 1963 en vertu du traité de l’Élysée signé par De Gaulle et Adenauer. Sciences Po m’a servi, notamment pour parler aux stagiaires allemands de la France (histoire, politique, etc.). Parallèlement, je poursuivais mes activités en musique : rédaction de pochettes de disques, collaboration au magazine Harmonie, fondé en 1964 par notre amie Édith Walter. Et j’ai organisé et dirigé pour Peuple et Culture, à partir de 1961 et pendant dix ans, notamment dans le cadre de ses universités d’été, des stages de musique qui m’ont beaucoup appris sur les multiples façons dont on réagit à cet art.
En musique, tu n’as donc jamais fait le conservatoire ?
M.V. : Non, je suis très largement autodidacte, mais ayant fait du piano, je pouvais lire une partition et m’y connaissais relativement bien en analyse traditionnelle (subtilités de la forme sonate, etc.). Halbreich m’a beaucoup apporté en matière de musique contemporaine, et Sciences Po en matière de rédaction. Je raconte volontiers à ma fille comment, en 1956, j’ai passé l’écrit du certificat de littérature allemande à la Sorbonne. Six œuvres étaient au programme : Tonio Kröger de Thomas Mann, Par-delà le bien et le mal de Nietzsche, le Divan occidental-oriental de Goethe, les Élégies de Duino de Rilke et deux dont je ne me souviens plus. La veille de l’examen, à 17h, je ne savais rien du Goethe. Je l’ai donc acheté chez Gibert, et j’ai passé la soirée à potasser le texte lui-même ainsi que la préface de l’édition et à m’imprégner de quelques citations. Le lendemain matin, c’est Goethe qui est sorti comme sujet d’examen ; et j’ai été reçu. Ma formation à Sciences Po m’avait permis de rédiger une bonne dissertation, avec citations à l’appui, sur un sujet dont je n’avais aucune idée 24 heures auparavant.
J’imagine que cette formation t’a resservi et te sert encore aujourd’hui.
M.V. : Oui. Je me rappelle un article que Le Monde de la Musique m’a demandé au début des années 1990. Un film était sorti sur le neveu de Beethoven. Ce film espérait renouer avec le succès d’Amadeus de Forman mais a été un bide complet. J’ai donc pondu un article intitulé « Beethoven et son Neveu », il était trop long, on a voulu le couper, on n’y est pas parvenu, et Le Monde de la Musique a dû le publier intégralement.
Te souviens-tu de professeurs à Sciences Po qui l’ont beaucoup appris ?
M.V. : Il y en a un que je n’ai pas eu comme professeur mais que j’ai bien connu et qui m’a marqué : Alfred Grosser, qui va maintenant sur ses 99 ans. Il a écrit pas mal de livres sur l’Allemagne et la politique, dont dès 1952 L’Allemagne de l’Occident, qui a fait date. Il disait de ses travaux qu’ils faisaient office d’intermédiaires entre la recherche et le grand public. C’est ce que j’essaie de faire avec la musique. Je ne suis pas formé et surtout n’ai jamais eu les moyens pour faire de la recherche musicologique, mais je peux servir d’intermédiaire, avec comme avantage - pour Haydn en particulier - de maîtriser l’anglais et l’allemand.
Combien de langues parles-tu ?
M.V. : Je peux aussi comprendre et (avec l’aide d’un dictionnaire) lire l’italien, contrairement à l’espagnol. Ma connaissance des opéras de Mozart m’a aidé. Je parle aussi le néerlandais. Ma grand-mère maternelle venait d’Amsterdam et parlait toujours le néerlandais avec ma mère. Elles m’ont dit qu’à cinq ans j’étais bilingue. Elles ont arrêté pendant la guerre, car cela ressemblait à l’allemand, et s’y sont ensuite remises. A la rentrée 1944 j’ai commencé l’allemand, je suis allé régulièrement en Hollande à partir de 1947, et le néerlandais m’est revenu.
Cette langue t’a-t-elle servi ?
M.V. : À lire des livres, dont dans les années 2000 le premier volume d’une biographie de Mengelberg. En 1962 est paru en Hollande un livre sur les symphonies de Sibelius. Halbreich et moi l’avons découvert et acheté ensemble sur place, à Leyde, et j’en ai rendu brièvement compte en 1963, à l’occasion de mon deuxième séjour en Finlande, dans un journal musical suédois.
Quels sont tes premiers travaux biographiques ?
M.V. : En 1964-1965 un petit Haydn et un petit Sibelius dans la collection « Musiciens de tous les temps » chez Seghers. Par l’intermédiaire de l’écrivain Emmanuel Roblès, que j’ai connu à Peuple et Culture et qui publiait au Seuil, je suis entré en contact avec François-Régis Bastide, et il est résulté en 1966 mon Mahler dans la collection « Solfèges ». Par une quasi-collègue à Peuple et Culture, une sociologue, j’ai pu faire en 1962 la connaissance de Jean et Brigitte Massin. Nos chemins se sont croisés.
Tu t’intéressais à la musique contemporaine ?
M.V. : J’allais avec Halbreich aux concerts du Domaine Musical. À la création de Pli selon pli, il m’a dit : « On vit un moment historique. » Alors que par la suite, il s’est montré hostile à Boulez. On entendait et voyait Stockhausen ou Kagel, et on apercevait Francis Poulenc, qui habitait à deux pas de l’Odéon.
Et après ?
M.V. : En janvier 1979, mon salariat à Peuple et Culture a pris fin, on m’a licencié pour raisons économiques. Mais j’en suis devenu président en octobre suivant, jusqu’en 1989. J’ai tourné en rond quelque temps, puis on m’a appelé pour le dictionnaire Larousse.
Dans lequel j’ai tant appris !
M.V. : Je connaissais des gens chez Larousse, mon cousin y travaillait. On m’a donc appelé en 1980 pour « diriger » ce dictionnaire à la suite d’Antoine Goléa, qu’on avait remercié.
Pourquoi ?
M.V. : Je l’ignore, mais sûrement pas parce qu’il y avait trop d’articles de et sur Colette Herzog (rires).
C’est toi qui as choisi les collaborateurs ?
M.V. : Beaucoup étaient déjà là. J’en ai choisi d’autres. Halbreich n’était pas disponible, mais ont collaboré notamment Pierre Vidal, Roger Tellart (pour Monteverdi), Gilles Cantagrel. Parallèlement, Jean Nithart m’a commandé en 1979 le gros Haydn pour Fayard. Nithart avait inauguré sa collection en rééditant le Beethoven et le Mozart de Brigitte et Jean Massin, anciennement parus au Club français du livre. Brigitte Massin allait se mettre à Schubert, et à Nithart lui demandant comment enrichir sa collection, elle a répondu : « Demandez un Mahler à Henry-Louis de la Grange et un Haydn à Marc Vignal. »
Tu as mis dix ans à l’écrire ?
M.V. : Oui, à la machine, mais il m’est arrivé de rester six mois sans rien faire. Il a été rédigé pour moitié en neuf ans, et pour le reste en une année. Il est paru en décembre 1988, le temps que j’y ai consacré correspond à celui de ma présidence à Peuple et Culture.
Un livre de référence…
M.V. : Qui pourrait être revu, en particulier sur la datation des premières symphonies.
Tu t’es rendu à Vienne ?
M.V. : La première fois en 1952, la deuxième fois pour le Mahler en 1964, puis fréquemment pour des raisons diverses, y compris le tourisme, pas spécialement pour le Haydn. Après Larousse, j’ai intégré la radio au milieu des années 1980, on m’a confié pendant environ quatre ans la rédaction des textes de programme des concerts.
Et ta rencontre avec Charles Rosen ?
M.V. : J’avais lu The Classical Style. Par je ne sais plus quel canal, on m’en a demandé vers 1972 la traduction française. J’ai fait sa connaissance, et on a revu des passages ensemble. Cette traduction est parue en 1976.
Dans la suite de tes publications chez Fayard, avant le Sibelius, il y a Les Fils Bach, Haydn et Mozart.
M.V. : Un jour, Benoît Duteurtre, chargé de relancer la collection « Solfèges », m’a demandé un Fils Bach, tout en assurant la réédition du Mahler. Mais ce projet a été abandonné, et Les Fils Bach – largement augmenté – a atterri en 1997 chez Fayard. Le Haydn et Mozart provient de la programmation 2002 de la Folle Journée de Nantes. Le Sibelius, paru en décembre 2004, m’a demandé cinq ou six années de travail. Je me suis rendu pour le parachever à la Bibliothèque nationale de Finlande, où sont conservés de précieux documents inédits. Mon livre n’a pas été traduit en finnois, mais le musicologue britannique Robert Layton, spécialiste du compositeur, a eu la gentillesse de m’écrire que c’était « le meilleur livre sur Sibelius, toutes langues confondues ».
Ce livre est un monument !
M.V. : Et il ne s’arrête pas à Tapiola. Il y a bien des choses à dire après Tapiola, sur les affres de la Huitième Symphonie, le « silence de Järvenpää », les affaires Adorno, Karajan et Leibowitz, les guerres de 1940 et de 1941-1944 ou le 90e anniversaire. Sibelius est resté silencieux pendant trente ans, mais ne s’est jamais retiré du monde. S’il était mort en 1934, on disposerait sans doute du premier mouvement de la Huitième, et on se désolerait d’avoir une Inachevée de plus…
La radio a été ton dernier employeur ?
M.V. : J’ai souvent participé le samedi après-midi sur France Musique à « Désaccord parfait » de Jean-Michel Damian et réalisé moi-même jusqu’en 1998, date de mon départ à la retraite à 65 ans, plusieurs de ces inoubliables séries de 9h à 12h du lundi au vendredi : quinze heures d’émission sur un sujet ! J’en ai fait sur Cherubini, Mendelssohn, Sibelius, le piano à l’époque de Beethoven, Vienne, Beethoven jusqu’à l’Héroïque, ou encore Haydn jusqu’en 1765. Je tiens maintenant à rester tant soit peu actif, on peut me lire dans Classica et sur le site de musikzen ; et du Michael Haydn de 2009 au Muzio Clementi de 2024, j’ai pu publier six ouvrages dans la collection « Horizons », chez Bleu Nuit.
Propos recueillis par Jérémie Bigorie, le 15 décembre 2023

